Les Gaiasaures (Gaiasaura
gigans)
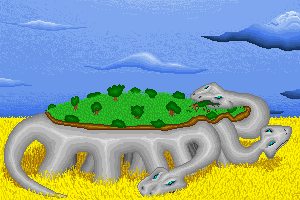 Les aborigènes d'Austrasie évoquent, dans leurs
mythes, les premiers temps du monde, où tout n'était encore qu'une
masse chaotique de magma en fusion ; ils parlent d'un âge sans âge,
où des dieux titanesques descendus sur la terre s'affrontaient sans répit,
se noyaient en faisant pleuvoir des océans, et arrachaient des continents
en guise de massues... les insectes de cet âge étaient des dinosaures
mille fois plus énormes que ceux qu'il y eut par la suite. Pour les aborigènes
austrasiens, l'univers n'est pas en expansion mais en rétractation permanente,
et tout finit toujours par succomber sous l'assaut du plus petit, à toutes
les échelles. Ainsi, lorsque les dieux-cyclopes eurent disparu, quand
leur corps corrompu forma les continents mouvants que nous connaissons, quand
le monde se fut rétréci à la mesure de l'homme, et que
toutes ces chimères eurent été renvoyées comme dans
un ancien cauchemar, la plupart des créatures de ce temps s'éteignirent,
tandis que d'autres, irrésistiblement poussées à survivre
par une adaptation humiliante, se miniaturisèrent, se lilliputisèrent
; les Gaiasaures furent de celles-là.
Les aborigènes d'Austrasie évoquent, dans leurs
mythes, les premiers temps du monde, où tout n'était encore qu'une
masse chaotique de magma en fusion ; ils parlent d'un âge sans âge,
où des dieux titanesques descendus sur la terre s'affrontaient sans répit,
se noyaient en faisant pleuvoir des océans, et arrachaient des continents
en guise de massues... les insectes de cet âge étaient des dinosaures
mille fois plus énormes que ceux qu'il y eut par la suite. Pour les aborigènes
austrasiens, l'univers n'est pas en expansion mais en rétractation permanente,
et tout finit toujours par succomber sous l'assaut du plus petit, à toutes
les échelles. Ainsi, lorsque les dieux-cyclopes eurent disparu, quand
leur corps corrompu forma les continents mouvants que nous connaissons, quand
le monde se fut rétréci à la mesure de l'homme, et que
toutes ces chimères eurent été renvoyées comme dans
un ancien cauchemar, la plupart des créatures de ce temps s'éteignirent,
tandis que d'autres, irrésistiblement poussées à survivre
par une adaptation humiliante, se miniaturisèrent, se lilliputisèrent
; les Gaiasaures furent de celles-là.
Car chacun sait que les Gaiasaures
d'ajourd'hui ne sont que les faibles cousins de ceux qu'ils furent par le passé.
Ces monstres qui, à tout autre qu'à un natif d'Austrasie, paraîtraient
défier les lois de la nature, ne sont rien d'autre que l'expression de
l'écoulement du temps universel, de la diminution entropique de toute
chose. Les Gaiasaures sont des dragons myriapodes et tricéphales qui
vivent dans les savanes jaunes d'Austrasie, se déplaçant constamment,
quoique très lentement, et engloutissant des quantités inouïes
de végétation sur leur passage, quand ils n'écrasent pas
les forêts ou n'aplanissent pas les petites montagnes sous leurs pieds.
Leur taille se compte en kilomètres, en miles, en verstes ; ils
mesurent en moyenne deux ou trois kilomètres de long, en comptant la
queue et le cou, et à peu près cinq cent mètres de hauteur
au garrot (quant à leurs têtes, elles se balancent souvent à
plus d'un kilomètre du sol quand ils lèvent un peu leurs cous).
Pour qui les regarde d'en bas, les
Gaiasaures apparaissent d'abord comme une monstrueuse forêt d'innombrables
piliers plus épais que des donjons, couverts d'une peau grise et ridée
comme celle d'un éléphant ou d'un rhinocéros. On ignore
par quel miracle de la nature ils parviennent à simplement survivre et
se mouvoir aussi facilement avec un corps aussi démesuré. On estime
le nombre des pattes d'un Gaiasaure à environ un millier, avec une marge
d'erreur de cinquante ou soixante (car le dénombrement n'est pas aisé,
n'importe quel naturaliste vous le dira). A l'arrière, une épaisse
queue plane à quelques dizaines de mètres du sol, ou vient fouetter
les herbes. A l'avant, il faut lever la tête pour apercevoir, haut dans
le ciel, trois têtes triangulaires non moins énormes que le reste,
aux mâchoires aplaties, qui circulent en masses grises sur le bleu intense
du ciel austrasien, reliées au corps par trois cous ronds plus longs
et plus gigantesques que des dizaines de guivres tressées entre elles.
Lorsqu'on se trouve relativement près d'un de ces monstres, il est difficile
de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un seul et même animal ; on
est plutôt tenté de penser en termes d'éléments séparés,
"la première (ou) la seconde tête", "la queue"
voire "le bout de la queue", "la forêt de pattes",
"le cou", "le ventre", etc.
De fait, certains peuples ne conçoivent
pas les Gaiasaures comme des individus, mais comme des sortes de tempêtes
d'organes mettant en présence diverses parties de corps d'animaux démesurément
agrandies ; chez les pygmées du Nord, tout comme chez certains peuples
de géants, "tremblement de terre" et "ouragan" ne
sont qu'un seul et même mot, qui désignentle passage sur un pays
de la forêt de pieds-piliers d'un Gaiasaure. Cela paraît relativement
logique, puisqu'ils n'en voient presque jamais les têtes, et encore moins
le dos.
Ce n'est que lorsqu'on s'éloigne
(mais alors de plusieurs kilomètres) d'un Gaiasaure, au besoin en
prenant un peu de hauteur par magie ou à bord d'un engin volant, que
l'on peut se rendre compte qu'il s'agit bien d'un seul et même animal.
Les trois têtes sont alors mieux visibles : elles ont l'allure de tête
de serpents ou de dragons dépourvues d'oreilles et de cornes, portant
sur le museau deux naseaux aussi grands que des cratères de volcans ;
de part et d'autre du front en pente douce, les yeux, étonnamment vifs
pour des créatures en apparence si placides, brillent d'un bleu-vert
glacial, qu'on a du mal à fixer longtemps. Au demeurant, il est à
peu près impossible de croiser le regard d'une de ces paires d'yeux,
qui ont toujours l'air de fixer quelque chose à des dizaines d'horizons
de distance, même quand elles sont braquées sur les herbes hautes.
 Mais
c'est le dos qui retient l'attention le plus longtemps : il semble qu'à
l'origine, les Gaiasaures n'aient possédé qu'une carapace à
peu de chose près semblable à celle de nombreux autres dinosauriens,
recouvrant seulement la partie supérieure du dos, légèrement
évasée à trois endroits sur le devant pour permettre aux
trois cous de mieux se mouvoir. Cependant, cette carapace supporte elle-même
un pays tout entier, avec son herbe haute, ses groupes d'arbres et ses forêts,
parfois même ses lacs et ses sources. Et ce ne sont pas des buissons ou
des arbustes, mais bel et bien des arbres géants, épicéas
ou baobabs, voire d'autres espèces plus grandes encore, et qui abritent
quelquefois des peuples entiers entre leurs branches.
Mais
c'est le dos qui retient l'attention le plus longtemps : il semble qu'à
l'origine, les Gaiasaures n'aient possédé qu'une carapace à
peu de chose près semblable à celle de nombreux autres dinosauriens,
recouvrant seulement la partie supérieure du dos, légèrement
évasée à trois endroits sur le devant pour permettre aux
trois cous de mieux se mouvoir. Cependant, cette carapace supporte elle-même
un pays tout entier, avec son herbe haute, ses groupes d'arbres et ses forêts,
parfois même ses lacs et ses sources. Et ce ne sont pas des buissons ou
des arbustes, mais bel et bien des arbres géants, épicéas
ou baobabs, voire d'autres espèces plus grandes encore, et qui abritent
quelquefois des peuples entiers entre leurs branches.
Il arrive que les habitants de
ce "pays dorsal" ne se doutent même pas qu'ils vivent sur le
dos d'un tel animal. Mais il arrive aussi (et plus souvent, semble-t-il) que
ces peuples connaissent l'existence de leur hôte, et en viennent à
lui rendre un culte ou à nouer avec lui une relation particulière.
Les corps mêmes des Gaiasaures sont si gigantesques qu'il est assez aisé
de bâtir des villages sur la queue, sur les cous (ou entre les cous) ou
même sur les fronts, si les habitations sont assez solides pour résister
aux mouvements de l'animal. Les rites locaux des Gaiates (ou gaiachtones, ou
gaiagènes, ou encore Hommes du Dos, tous peuples qui habitent les Gaiasaures)
ont souvent pour but d'éviter que les têtes du Gaiasaure ne viennent
trop souvent brouter certains endroits de son dos où se trouvent les
habitations et les cultures.
Car les pays que transportent les
Gaiasaures leur servent aussi de réserve de nourriture, ce qui évite
aussi à l'écosystème de devoir supporter l'intégralité
de leurs besoins alimentaires. Tous les jours ou presque, un Gaiate habitant
la région des Cous pourra voir une ou plusieurs têtes approcher
dans le ciel au bout des cous arrondis, pour venir arracher trois ou quatre
arbres, voire des dizaines à la fois quand la "bouchée"
est plus conséquente...
Il y a toujours un endroit du dos,
non loin de la queue, où le "pays" se change en un marécage
bursouflé de geysers de gaz pestilentiels et d'éruptions de boue.
Selon les naturalistes, il s'agit d'un moyen d'excrétion propre à
ces créatures, trouvaille on ne peut plus heureuse lorsqu'on en vient
à songer aux montagnes d'excréments qu'auraient pu produire de
tels continents vivants faute de cette solution. Ces gaz et cette boue sont
d'ailleurs fort utiles aux habitants des Dos comme combustible et comme ciment,
faute de mieux, car les Gaiasaures apprécient peu qu'on leur creuse la
carapace pour en extraire la corne ; ils auraient vite fait de gagner l'océan
ou l'un des Grands lacs d'Austrasie pour s'y plonger et éliminer leurs
parasites devenus trop gênants. Mais en fait, on observe d'importantes
différences en fonction des espèces ou peut-être simplement
selon les individus : il existe, à ce qu'on dit, des Gaiasaures dont
le dos n'est qu'une énorme montagne, aussi grande que celles du sol,
et qui culmine parfois à 2000 ou 3000 mètres ; les habitants de
telles montagnes n'ont pas la moindre difficulté à en extraire
des minéraux.
 D'autres
Gaiasaures ont le dos concave et transportent des mers fermées ;
sur d'autres, ce sont des geysers, dont l'eau coule de leur dos en cascades
diluviennes et va noyer les régions où ils passent. D'autres enfin,
à ce qu'on dit, car on n'en a jamais vu depuis longtemps, sauf peut-être
près des Bords Chaotiques ou du Désert des Transplans (mais ce
n'est pas en Austrasie... non ?), ont des ailes sous leur carapace, comme des
scarabées-continents, et quand ils ouvrent leur dos en deux pour les
déployer et s'envoler, c'est un spectacle terrible et merveilleux pour
ceux qui sont dessus et ceux qui sont dessous : de tels Gaiasaures, devenus
Ouranosaures, atteignent une dizaine de kilomètres d'envergure. Certains
anciens érudits évoquèrent même jadis des Cosmosaures
capables d'atteindre l'espace, voire de voyager entre les plans dans tout le
Multivers (certains Voyageurs de la Guide Multiverselle ont cru reconnaître
un Cosmosaure de taille particulièrement remarquable dans la description
que donne le Voyageur Ther Rh'Ypr Atchet de la tortue A'Tuin, qui porte quatre
éléphants qui portent un continent nommé le Disque-Monde).
Mais on a des raisons de douter de la véracité des récits
qui évoquent de tels décollages : comment des monstres si énormes
pourraient-ils faire voler le poids disproportionné de leur corps ?
D'autres
Gaiasaures ont le dos concave et transportent des mers fermées ;
sur d'autres, ce sont des geysers, dont l'eau coule de leur dos en cascades
diluviennes et va noyer les régions où ils passent. D'autres enfin,
à ce qu'on dit, car on n'en a jamais vu depuis longtemps, sauf peut-être
près des Bords Chaotiques ou du Désert des Transplans (mais ce
n'est pas en Austrasie... non ?), ont des ailes sous leur carapace, comme des
scarabées-continents, et quand ils ouvrent leur dos en deux pour les
déployer et s'envoler, c'est un spectacle terrible et merveilleux pour
ceux qui sont dessus et ceux qui sont dessous : de tels Gaiasaures, devenus
Ouranosaures, atteignent une dizaine de kilomètres d'envergure. Certains
anciens érudits évoquèrent même jadis des Cosmosaures
capables d'atteindre l'espace, voire de voyager entre les plans dans tout le
Multivers (certains Voyageurs de la Guide Multiverselle ont cru reconnaître
un Cosmosaure de taille particulièrement remarquable dans la description
que donne le Voyageur Ther Rh'Ypr Atchet de la tortue A'Tuin, qui porte quatre
éléphants qui portent un continent nommé le Disque-Monde).
Mais on a des raisons de douter de la véracité des récits
qui évoquent de tels décollages : comment des monstres si énormes
pourraient-ils faire voler le poids disproportionné de leur corps ?
On ignore comment se reproduisent
les Gaiasaures, et l'on ignore même s'ils ont un quelconque mode de reproduction.
D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils ont besoin de se reproduire, car
personne n'a jamais vu de Gaiasaure mort, ni n'en a découvert de vestige.
A coup sûr, la vie d'un Gaiasaure doit se compter en millénaires.
Mais comment diable le continent d'Austrasie n'a-t-il pas été
rendu définitivement aride et désertique par de pareils engloutisseurs
de forêts et de savanes ? Certes, quand on parle d'herbes hautes, il faut
entendre des herbes de deux ou trois mètres de haut ; et en Austrasie,
quand on parle des Hautes Herbes, il faut parler de plusieurs dizaines de mètres
de haut, mais les plaines et savanes de Hautes Herbes ne sont pas si fréquentes.
Un autre problème a fait frémir les naturalistes hiscontes lorsqu'ils
ont débarqué par hasard en Austrasie après la longue errance
d'une de leurs expéditions sur le Grand Océan : quel peut bien
être le prédateur capable de tuer et de manger un Gaiasaure
?
Mais les hiscontes savent préserver
leur vie, et ils savent aussi depuis longtemps que certaines questions savent
de venger de ceux qui les posent... L'expédition qui observa les premiers
Gaiasaures ne resta que quelques semaines, et se contenta, sur beaucoup de points,
des récits des Mages de Peau et des Hommes Illustrés aborigènes.
Mieux valait d'ailleurs, malgré la remarquable hospitalité de
ceux-ci, ne pas s'attarder : le Nonsense se manifesta à plusieurs reprises
en quelques jours, et quand l'expédition reprit le large à ses
risques et périls, l'un des naturalistes s'était couvert de touffes
de sang, un autre avait vu l'un de ses bras se changer en émeraude, et
un troisième ne pouvait plus s'exprimer qu'en utilisant les trois mots
"terre", "caracoler" et "cataplasme".
Renseignements :
|
Fréquence :
|
jadis courant, aujourd'hui très
inhabituel en Austrasie, mythique ailleurs.
|
Nourriture :
|
herbivore (Hautes herbes et groupes
d'arbres trouvés au sol ou sur leur propre dos)
|
|
Taille :
|
immense (jusqu'à 3 kilomètres
de long et 600 mètres au garrot)
|
Indice de légende :
|
7
|
|
Armes naturelles :
|
masse incommensurable, pieds-piliers,
queue-paquebot, trois gueules capables d'avaler des baobabs en guise
d'apéritifs.
|
Déplacement :
|
pas 10/ trot 20/galop 25 (/vol
28)
|
Le Gaiasaure, pour Fantasia/BaSIC
- FOR 150
- CON 200 ou 300, sans doute
- TAI plus grande que ne peut mesurer
l'échelle prévue pour ce jeu. Si on compte en kilomètres,
ça donne 2 ou 3.
- APP 7
- INT probablement 10 ou 12 ; aucun signe
d'intelligence vis-à-vis des mages ou des prêtres de quelque
peuple que ce soit.
- POU 8-10
- DEX 10
- PV il serait idiot de prétendre
tuer ou même blesser sérieusement un Gaiasaure, il n'y a donc
pas besoin de mesurer ses Points de Vie.
- Bonus aux dommages : inutile
- Mouvement : 10 (pas) / 20 (trot) / 25
(galop) ( /28 (vol) )
- Armure naturelle : 50 au minimum (peau
épaisse de plusieurs mètres)
- Athlétisme 35%
- Mugir De Façon à Faire
Croire à Tout Le Monde Que C'est Le Tonnerre Ou La Fin Du Monde 60%
- Brouter Toute Végétation
55%
- Se Faire Passer Pour Un Continent 70%
- Vigilance 40%
- Armes naturelles :
- Ecraser de la patte 100% (la victime
n'a aucune chance, sauf solution magique)
- Mordre ou Avaler 60% (victime broyée
ou avalée ; aucune chance, sauf solution magique ou exploration héroïque
des entrailles, façon Pinocchio ; dans ce cas, à l'appréciation
du meneur de jeu)
 Ces
caractéristiques risquent de ne pas servir bien souvent. A moins qu'il
s'agisse d'une campagne épique où les Aventuriers se retrouvent
en mesure d'invoquer des armées entières de dragons ou encore
de déclencher une Chaotisation ou une Absurdisation complète d'une
région du monde (on me concèdera que même pour des Aventuriers,
ça ne doit pas arriver tous les jours, ou alors c'est qu'il y a un problème
!), il n'y a pas grand-chose de suffisamment puissant pour détruire ou
endommager un Gaiasaure. En fait, il n'y a même presque rien qui puisse
simplement attirer son attention. Le Gaiasaure est donc surtout destiné
à servir de décor : évoluer entre ses pattes, sur son dos
et son cou, même sur ses têtes, est déjà toute une
histoire, au vu de ses dimensions... Dans le reste des cas, c'est-à-dire
: si les Gaiasaures deviennent par exemple l'élément principal
d'une campagne ou d'un gros scénario, ce sera au Meneur de Jeu de décider
de l'évolution des choses et du moyen à trouver pour blesser/tuer/communiquer
avec/changer ou guider le parcours d'/faire s'arrêter/ faire voler/empêcher
de manger/obliger à manger un Gaiasaure. Dans tous les cas, le succès
ou l'échec d'événements de ce genre relèveront d'une
décision du meneur de jeu à l'échelle du scénario/de
la campagne, et non du simple jet de dé d'un joueur.
Ces
caractéristiques risquent de ne pas servir bien souvent. A moins qu'il
s'agisse d'une campagne épique où les Aventuriers se retrouvent
en mesure d'invoquer des armées entières de dragons ou encore
de déclencher une Chaotisation ou une Absurdisation complète d'une
région du monde (on me concèdera que même pour des Aventuriers,
ça ne doit pas arriver tous les jours, ou alors c'est qu'il y a un problème
!), il n'y a pas grand-chose de suffisamment puissant pour détruire ou
endommager un Gaiasaure. En fait, il n'y a même presque rien qui puisse
simplement attirer son attention. Le Gaiasaure est donc surtout destiné
à servir de décor : évoluer entre ses pattes, sur son dos
et son cou, même sur ses têtes, est déjà toute une
histoire, au vu de ses dimensions... Dans le reste des cas, c'est-à-dire
: si les Gaiasaures deviennent par exemple l'élément principal
d'une campagne ou d'un gros scénario, ce sera au Meneur de Jeu de décider
de l'évolution des choses et du moyen à trouver pour blesser/tuer/communiquer
avec/changer ou guider le parcours d'/faire s'arrêter/ faire voler/empêcher
de manger/obliger à manger un Gaiasaure. Dans tous les cas, le succès
ou l'échec d'événements de ce genre relèveront d'une
décision du meneur de jeu à l'échelle du scénario/de
la campagne, et non du simple jet de dé d'un joueur.
Retourner
à la Faune Fantasienne
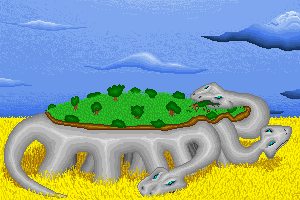 Les aborigènes d'Austrasie évoquent, dans leurs
mythes, les premiers temps du monde, où tout n'était encore qu'une
masse chaotique de magma en fusion ; ils parlent d'un âge sans âge,
où des dieux titanesques descendus sur la terre s'affrontaient sans répit,
se noyaient en faisant pleuvoir des océans, et arrachaient des continents
en guise de massues... les insectes de cet âge étaient des dinosaures
mille fois plus énormes que ceux qu'il y eut par la suite. Pour les aborigènes
austrasiens, l'univers n'est pas en expansion mais en rétractation permanente,
et tout finit toujours par succomber sous l'assaut du plus petit, à toutes
les échelles. Ainsi, lorsque les dieux-cyclopes eurent disparu, quand
leur corps corrompu forma les continents mouvants que nous connaissons, quand
le monde se fut rétréci à la mesure de l'homme, et que
toutes ces chimères eurent été renvoyées comme dans
un ancien cauchemar, la plupart des créatures de ce temps s'éteignirent,
tandis que d'autres, irrésistiblement poussées à survivre
par une adaptation humiliante, se miniaturisèrent, se lilliputisèrent
; les Gaiasaures furent de celles-là.
Les aborigènes d'Austrasie évoquent, dans leurs
mythes, les premiers temps du monde, où tout n'était encore qu'une
masse chaotique de magma en fusion ; ils parlent d'un âge sans âge,
où des dieux titanesques descendus sur la terre s'affrontaient sans répit,
se noyaient en faisant pleuvoir des océans, et arrachaient des continents
en guise de massues... les insectes de cet âge étaient des dinosaures
mille fois plus énormes que ceux qu'il y eut par la suite. Pour les aborigènes
austrasiens, l'univers n'est pas en expansion mais en rétractation permanente,
et tout finit toujours par succomber sous l'assaut du plus petit, à toutes
les échelles. Ainsi, lorsque les dieux-cyclopes eurent disparu, quand
leur corps corrompu forma les continents mouvants que nous connaissons, quand
le monde se fut rétréci à la mesure de l'homme, et que
toutes ces chimères eurent été renvoyées comme dans
un ancien cauchemar, la plupart des créatures de ce temps s'éteignirent,
tandis que d'autres, irrésistiblement poussées à survivre
par une adaptation humiliante, se miniaturisèrent, se lilliputisèrent
; les Gaiasaures furent de celles-là.